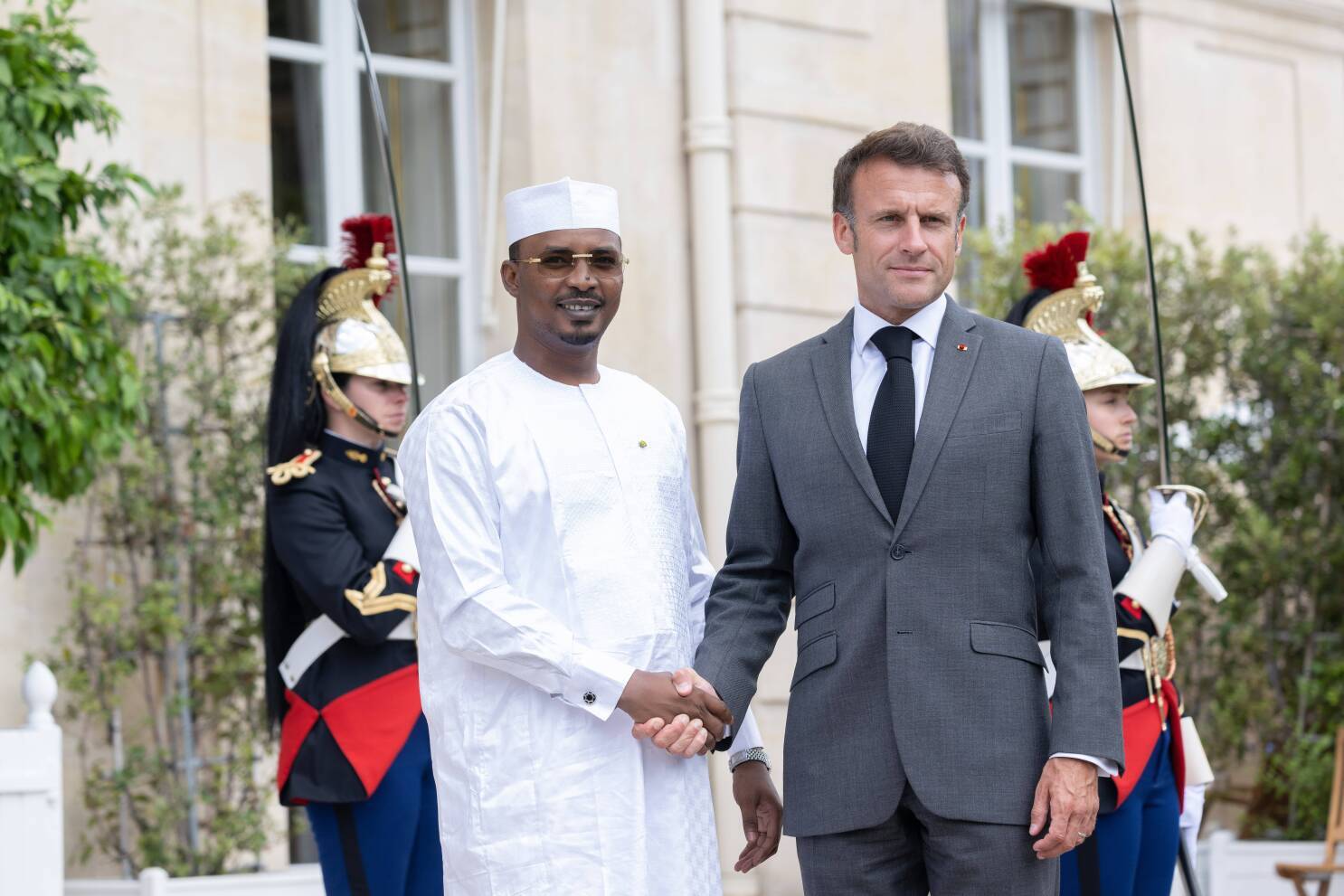Pour la première fois depuis sa création, et alors que la désinformation sape les fondements du monde tel que défini après la Seconde Guerre mondiale, la Voix d’Amérique risque de se taire. Définitivement. Cette perspective, qui fera incontestablement les affaires de la Chine, est analysée par Éric Topona Mocnga, journaliste à la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle (média international allemand), à Bonn.
Le 16 mars 2025, la nouvelle administration Trump a pris la décision de mettre en congé pour une « durée indéterminée », le personnel de la mythique radio internationale Voice of America (VOA) et Radio Free Europe/Radio Liberty. Cette réduction au silence de la Voix de l’Amérique, aussi soudaine que brutale pour son personnel à travers le monde, a résonné comme un coup de tonnerre dans l’univers des médias internationaux, voire des médias à travers la planète. Car VOA était pour l’Amérique ce que sont ses puissants satellites d’observation qui balaient la Terre tout entière jusqu’à ses recoins les plus reculés.
Le contexte de cette décision unilatérale, à savoir la suspension des activités de cette puissante voix de l’Amérique dans le monde semble pourtant militer pour son renforcement, à telle enseigne que l’on est en droit de se poser la question de savoir si le moment a été judicieusement choisi pour prendre une telle décision. Il y a d’abord la position éminente des États-Unis sur la scène géopolitique mondiale.
En effet, l’Amérique est au cœur de tous les grands enjeux qui régulent ou dérégulent l’ordre international issu des accords de Yalta (11 février 1945). Or, ce monde est en pleine reconfiguration comme on peut le voir actuellement avec le grand chamboulement en cours dans le commerce international et, pour remonter plus loin, avec la guerre en Ukraine qui affecte à des degrés divers l’ensemble des États de la planète.
Aussi les principaux protagonistes dans ce conflit, notamment depuis ses débuts, rivalisent-ils d’adresse et d’efficacité pour faire entendre leur narratif ; qu’il s’agisse de la Russie, de l’Union européenne, voire des États-Unis sous la présidence de Joe Biden.
Réduire au silence la VOA alors que la guerre en Ukraine n’est pas terminée, que le cessez-le-feu demeure manifestement lointain, hormis dans les discours du nouveau locataire de la Maison-Blanche, c’est manifestement la preuve que Donald Trump ne considère plus l’Amérique comme l’un des belligérants dans ce conflit.
Même si l’Amérique, comme c’est le cas, œuvre tout au moins officiellement pour une cessation de la guerre en Ukraine, il est dans son intérêt de faire connaître au reste du monde les raisons de ce revirement diplomatique et les dividendes que ce processus de pacification apporte au reste du monde.
Manque de lisibilité
Bien plus, la diplomatie américaine pâtit aujourd’hui d’un manque de lisibilité dans les deux dossiers internationaux majeurs de la présidence Trump que sont la guerre en Ukraine et la question israélo-palestinienne dans la bande de Gaza. Nul ne peut dire aujourd’hui avec clarté et certitude où va l’Amérique dans ces deux conflits.
Les débuts tonitruants de la présidence Trump au sujet de la guerre russo-ukrainienne, dans le droit fil de ses promesses de campagne visant à y mettre un terme « en 24 heures », sont retombés comme un soufflé.
La « voix de l’Amérique » dans ce conflit est de moins en moins audible. Le département d’État américain s’est privé, avec le démantèlement de la VOA, d’un précieux adjuvant de communication qui aurait pu tout au moins apporter au reste du monde des informations, des clarifications que n’apporteront jamais les points de presse de la Maison-Blanche qui ne sont suivis que d’une infime élite médiatique et politique à l’échelle internationale, y compris aux États-Unis d’Amérique.
Le ballet diplomatique de Steve Witkoff, l’émissaire de Donald Trump auprès de Vladimir Poutine, n’est désormais évoqué que de manière lapidaire par les grands médias occidentaux. Le constat est le même dans le conflit au Proche-Orient.
Contrairement à l’idée que pourrait se faire le président américain de ce conflit, il ne s’agit pas seulement d’un différend qui ne concerne qu’Israéliens, Palestiniens et Américains. C’est un conflit qui mobilise l’attention et engage les peuples sur quasiment tous les continents.
Preuve en est faite dans les manifestations récurrentes dans toutes les grandes métropoles mondiales, y compris en Afrique, comme récemment en Mauritanie ou dans les campus des grandes universités occidentales.
Le président américain, qui s’est érigé en faiseur de paix au début de son mandat, peine aujourd’hui à expliquer au reste du monde où il va, qu’elle est réellement sa feuille de route, comment parvenir au bout du tunnel.
La voix officielle de l’Amérique ne se fait plus entendre au sujet du règlement de ce conflit, tant et si bien que c’est la capacité des États-Unis à s’ériger en gendarme du monde et en garant d’une relative stabilité internationale qui perd grandement en crédibilité.
L’importance pour toute diplomatie à vocation internationale et à l’influence planétaire, à l’instar de celle des États-Unis d’Amérique, de disposer d’un outil d’information et de persuasion en direction du reste du monde, se justifie comme jamais dans le contexte actuel de la guerre commerciale que le président américain Donald Trump a choisi de livrer quasiment avec le reste du monde.
Un outil de communication planétaire tel que la VOA est d’autant plus important que, depuis que la Maison-Blanche et son cercle très restreint de conseillers ont lancé cette guerre commerciale, nul ne peut dire quelle est la vision de l’Amérique dans la confrontation géopolitique en cours. Toute la planète, y compris les médias et les dirigeants politiques de premier plan en sont réduits à scruter, comme le passage de l’éclipse, les points de presse quotidiens de la Maison-Blanche ou les déclarations inopinées, parfois à la cantonade, de Donald Trump.
Le musellement de la Voix de l’Amérique au regard de l’importance, voire de la gravité des trois enjeux géopolitiques évoqués ci-dessus, n’est certainement pas un banal coup de sang de la nouvelle diplomatie américaine.
Verticalité du pouvoir
Lorsque l’on observe la conduite des affaires à Washington depuis le 20 janvier 2025, force est de constater que Donald Trump a bâti son second mandat sous le signe d’une verticalité absolue du pouvoir d’État qu’il tient à incarner seul. Autrement dit, l’État c’est lui, pour paraphraser Louis XIV.
Tout part de lui et tout revient à lui. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle durant ces quelques jours où l’économie mondiale a failli basculer dans la récession généralisée et le chaos, du fait de sa gestion erratique du pouvoir, nul dans son entourage ou parmi les contre-pouvoirs institutionnels qui auraient pu lui faire entendre raison n’a osé prendre le risque de lui porter la contradiction, tout au moins de l’inviter à la mesure.
La VOA, qui est un contre-pouvoir, quoique sous la tutelle du département d’État, comme le sont en France Radio France internationale (RFI) ou la chaîne de télévision France 24 sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, aurait pu faire entendre des sons de cloche différents, voire des voix dissonantes mais utiles, issus de ses adversaires politiques démocrates, y compris républicains, ou des milieux de la haute finance américaine.
Le soft power américain mis à mal
Bien au-delà de ces dossiers brûlants de l’actualité internationale sur lesquels la Voix de l’Amérique ne pourra plus s’exprimer, pour une « durée indéterminée », cette décision de l’administration américaine n’est pas sans questionner l’idée qu’elle se fait du soft power américain.
C’est connu depuis au moins le XIXe siècle, la seule capacité de coercition, la puissance militaire seule ne suffit pas à asseoir une hégémonie politique ou géopolitique. Un pouvoir ne doit pas seulement être redouté ou craint, il doit aussi, même de manière marginale, séduire les masses qu’il veut avoir sous son joug.
Pour exemple, la colonisation européenne en Afrique n’a pas seulement été rendue possible par les seuls moyens du fusil, de l’épée ou de la baïonnette. Anglais, Français et Portugais se sont également dotés d’outils culturels pour rendre l’Europe désirable par les Africains, au premier rang desquels la langue, la religion et l’instruction.
Au XXe siècle, la guerre froide ne fut pas seulement une course aux armements entre Soviétiques et Américains, entre le Bloc de l’Est et le Bloc de l’Ouest. Tous les outils de la création et les forces qui les produisent furent mises à contribution par l’un ou l’autre camp pour convaincre de la supériorité ou de l’excellence de son modèle de société.
Comme le définit fort opportunément une étude française de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), « le soft power désigne la capacité pour un État d’influencer le comportement d’un autre état pour l’amener à adopter le même point de vue par le biais de moyens culturels et/ou idéologiques. Il mobilise des ressources basées sur l’attractivité et la séduction incarnées par son modèle culturel. Le soft power complète le hard power qui désigne les moyens traditionnels de toute politique étrangère : l’armée, les pressions diplomatiques et économiques […]. Le soft power combine donc l’initiative diplomatique, la séduction par l’image, la propagation des valeurs au service d’une politique étrangère globale d’influence et de rayonnement dont l’objectif est de bénéficier en retour de retombées économiques favorables ; facteurs de croissance et de développement. »
En supprimant la Voix de l’Amérique de l’espace des grands médias internationaux où elle tenait par ailleurs une place éminente, la présidence Trump a également démantelé en partie un outil précieux du soft power des États-Unis d’Amérique.
Imaginons la France sans Radio France internationale ou France 24, l’Allemagne sans la Deutsche Welle, la Russie sans Russia Today ou Sputnik, la Chine sans Xinghua ou la CCTV ! La Chine, qui livre actuellement une bataille commerciale et géopolitique décisive, a considérablement investi dans le soft power médiatique et en fait aujourd’hui un usage précieux et stratégique.
Une étude de 2024 du Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) conduite par le chercheur Paul Nantulya en donne un aperçu : « Xinghua, le plus grand conglomérat médiatique chinois possède 37 bureaux en Afrique […]. Un autre géant chinois des médias, StarTimes est le plus grand acteur de la télévision numérique africaine et le deuxième en Afrique après la DSTV sud-africaine. »
Il faut espérer que l’administration Trump, rattrapée par le principe de réalité, fasse son chemin de Canossa et revienne sur sa décision en restituant à la Voix de l’Amérique sa voix.