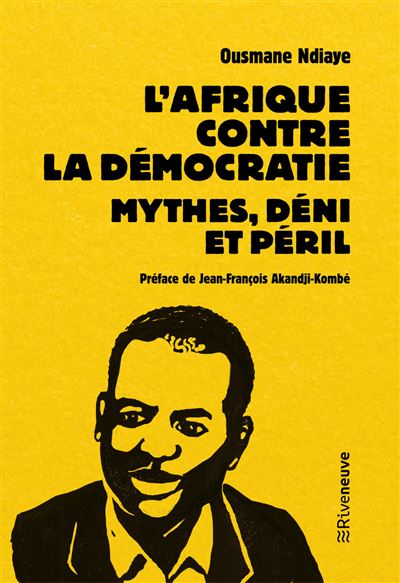
Ces temps derniers, certains, notamment au sein des juntes militaires de l’Alliance des États du Sahel (AES) et au-delà, tentent d’expliquer avec force conviction que la démocratie ne serait que l’apanage des Occidentaux. Le livre d’Ousmane Ndiaye, ancien rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde et responsable des pages Afrique de l’hebdomadaire Courrier International apparaît comme une réponse à cette croyance. Éric Topona Mocnga, journaliste à la rédaction Francophone de la Deutsche Welle, à Bonn (Allemagne) l’a lu en avant-première pour nous.
À la fin des années 90, une intellectuelle camerounaise, Axelle Kabou, publia un ouvrage au titre volontairement décapant et qui fit très grand bruit : Et si l’Afrique refusait le développement ?
Interpellateur, voire provocateur, cet essai se retrouva au milieu des controverses intellectuelles les plus véhémentes de cette époque. Ils furent nombreux qui ne se firent même pas le devoir de s’imprégner des thèses et des arguments de cette spécialiste des politiques de développement.
Pour quelques-uns, l’ouvrage d’Axelle Kabou était une commande occulte de quelques officines impérialistes ou néocoloniales qui brûlaient d’impatience de reprendre pied en Afrique pour imposer leurs politiques prédatrices, alors que d’autres y voyaient une manœuvre intellectuelle pour décrédibiliser l’innovation politique en cours en Afrique et fondée sur les réalités et les savoirs endogènes. Nous espérons que l’essai d’Ousmane Ndiaye, « L’ Afrique contre la démocratie, Mythes, Déni et Péril », échappera à un semblable procès.
Atmosphère de glaciation des libertés
La fin de de la Guerre Froide a suscité de grands espoirs dans de nombreux pays de la planète, notamment du côté des combattants de la liberté, des pourfendeurs des autoritarismes, des chantres de l’ouverture et de la démocratisation des sociétés politiques longtemps verrouillées à des fins idéologiques ou tyranniques.
L’Afrique subsaharienne, comme l’est de l’Europe et certains pays d’Asie, ont longtemps souffert de cette atmosphère de glaciation des libertés dans laquelle s’est longtemps trouvée plongée près de la moitié de l’humanité. Dès la fin des années 80, d’autres voix se font entendre sur le continent africain afin que ses peuples voient enfin se réaliser les fabuleuses et justes promesses du « soleil des indépendances », comme l’appelait de ses vœux le titre éponyme du romancier ivoirien Ahmadou Kourouma.
Tous les observateurs s’accordaient alors à dire que les politiques d’oppression, de négation des libertés fondamentales qui ont prévalu en Afrique durant plusieurs années, sont l’une des causes majeures du retard que l’Afrique aura accusé au lendemain de son accession à la souveraineté internationale. Comme l’attestent les nombreux exemples historiques que convoque Ousmane Ndiaye, la démocratie s’est imposée d’évidence comme le régime politique le mieux à même de libérer les énergies d’une Afrique formidablement créative, riche de la population la plus jeune au monde et d’un potentiel naturel à nulle autre pareil.
Passé ce printemps des libertés, quelques décennies plus tard, observe l’auteur, les reculs politiques observés ici et là, le retour des coups d’Etat militaires que l’on croyait à jamais disparus, la paupérisation des masses pourtant laborieuses, ont créé un terreau fertile sur lequel a germé et ne cesse de croître un discours virulent et pernicieux contre la « démocratie à l’occidentale ».
Parmi les intellectuels, au sein des sociétés civiles, parmi des politiques en mal d’inventivité idéologique, quelques-uns en viennent à se demander s’il ne faut pas « africaniser » la démocratie.
Espoirs déçus
L’auteur ne manque cependant pas de reconnaître la déception des peuples au regard du dévoiement qu’ont connu les processus démocratiques dans certains pays africains. Pour des visées strictement personnelles de perpétuation ad vitam aeternam de leur pouvoir, certains chefs d’État, portés par les thuriféraires de tous bords qui redoutent de voir disparaître leurs situations de rente et autres privilèges indûment acquis, en sont venus à désespérer les peuples, las de voir advenir les lendemains qui chantent.
Les modifications constitutionnelles taillées sur mesure pour le prince, ont vidé de sa substance la démocratie, notamment l’exigence de reddition des comptes, la mise en place de véritables politiques de justice sociale, la suppression dans les faits de toute possibilité d’alternance au sommet de l’État en faisant sauter le verrou de la limitation des mandats.
Du côté de l’Occident, notamment les pays européens au premier rang desquels la France, qui a multiplié les plaidoyers en faveur de la bonne gouvernance depuis le célèbre discours de la Baule en 1990, les peuples reprochent justement à l’Hexagone ses exigences de bonne gouvernance à géométrie variable, en fonction des accointances personnelles avec tel ou tel dirigeant.
Cette posture du deux poids deux mesures, a considérablement décrédibilisé la France officielle en Afrique, au point qu’une certaine élite médiatique et politique a conclu à l’émergence d’un profond sentiment anti-français. Or, souligne Ousmane Ndiaye, il ne s’agit absolument pas d’un sentiment anti-français, mais d’une exigence de cohérence à laquelle sont plus que jamais attachés les peuples africains, surtout à l’endroit d’une France qui a fait de certaines valeurs universelles, l’étendard de son humanisme, voire de son patrimoine civilisationnel.
Amalgame fâcheux
Ce faisant, les contempteurs actuels de la démocratie –ou du moins ce qu’ils considèrent comme telle – en Afrique, se sont engouffrés dans cette brèche pour donner du crédit à la thèse selon laquelle c’est la démocratie qui pose problème.
Bien plus, ils en sont venus à créer sans vergogne un amalgame fâcheux entre les principes et ceux qui les incarnent. À leurs yeux, l’implémentation de la démocratie en Afrique s’est d’ores et déjà soldée par un échec sans appel.
D’autre part, les errements comme les volte-face de l’ancienne puissance coloniale dans le respect de ses propres principes démocratiques, ont installé dans une certaine opinion publique africaine la conviction que ce n’est pas la démocratie qu’elle promeut en Afrique, mais la préservation de ses intérêts séculaires par le biais de certains « valets locaux ».
Si l’auteur, en toute lucidité, se fait l’écho de ces récriminations qui ne manquent pas quelquefois de pertinence, il déplore que cette posture fait le miel de ceux-là qui ont su canaliser la déception des peuples pour leur proposer des idéologies de rechange mais sans efficience ; celles-ci tiennent plutôt lieu de tremplin pour la satisfaction d’ambitions pouvoiristes ou d’intérêts personnels.
Ce discours réactionnaire, qui n’a eu de cesse de gagner du terrain sur fond d’un appel à un panafricanisme nébuleux, s’est avéré au fil des ans un alibi idéologique pour ces nombreux politiciens démagogues qui rencontrent un grand élan de sympathie dans l’Afrique contemporaine.
Ousmane Ndiaye le démontre à suffisance, ils ont à leur remorque des « influenceurs » experts et aguerris dans le maniement des réseaux sociaux et l’amplification de leurs messages mobilisateurs ou dénonciateurs, comme seuls savent le faire les « télévangélistes » des nouvelles églises dites réveillées.
À l’instar de ces prédicateurs à la petite semaine, ils excellent dans la complaisance et l’amalgame avec les faits historiques, comme les autres excellent dans l’amalgame avec les textes religieux.
Tous ces discours d’une rupture qui n’est qu’apparente en arrivent à la conclusion selon laquelle « l’Afrique doit inventer son propre modèle » parce que la démocratie à l’occidentale ne mène l’Afrique nulle part.
L’heure est donc à la célébration des despotes africains « éclairés », de véritables caricatures de Bismarck qui excellent davantage dans l’imprécation contre un Occident dont ils demeurent pourtant proches par de discrets canaux, et la manipulation des foules.
Parvenus à cette mise à mort symbolique de la démocratie, ils en viennent à conclure que « l’Afrique a besoin d’hommes forts », comme un pied de nez à Barack Obama dans son célèbre discours au Parlement ghanéen à l’occasion de sa première tournée africaine durant son premier mandat à la Maison Blanche, le 11 juillet 2009.
Kagaméphilie
Une figure tient lieu d’icône pour ces zélateurs du retour à des régimes de fer comme gages de progrès pour l’Afrique : le chef de l’État rwandais Paul Kagame. C’est la figure emblématique citée en exemple, selon Ousmane Ndiaye, par les théoriciens « de la dictature éclairée ».
Sous la présidence à perpétuité de ce Bismarck africain, ils évoquent pêle-mêle le décollage économique du Rwanda en dépit du génocide dont ce pays a souffert, son incomparable leadership, l’attractivité économique du pays des mille collines, son art du soft power, et tant d’autres mérites et victoires engrangés qu’il serait fastidieux d’évoquer intégralement ici :
« Dans une Afrique en crise de leadership, peu de place à l’exigence. Il faut un héros ! La fascination Kagame est partout. Le grand magazine panafricain Jeune Afrique lui donne presque tribune ouverte. Son directeur de la rédaction, François Soudan est exégète et biographe admiratif de Kagame.
Il n’est pas le seul. La kagaméphilie fait des ravages chez les journalistes spécialistes du continent. Ousmane Ndiaye pointe par ailleurs le refus de distanciation critique de ceux-là qui se font les ambassadeurs et les VRP du « modèle rwandais ». Ils passent outre la réalité des statistiques, l’exagération des réussites d’une gouvernance qui n’est cependant pas sans mérite mais laquelle, en revanche, ne peut tenir lieu de philosophie de développement pour tout un continent.
Les États de la nouvelle Alliance des États du Sahel (AES), sont également cités en exemple comme les leaders charismatiques de cette « renaissance africaine » tant rêvée par les pères fondateurs de la pensée panafricaniste. Certains de ces dirigeants surfent sur cette musique, au point de dissoudre toutes les institutions démocratiques, d’instituer manu militari des présidences à vie, tout en se réclamant paradoxalement et sans scrupules de la souveraineté populaire.
Omniprésents sur les plateformes numériques, leurs équipes d’influenceurs ne se privent pas de travestir les réalités dans leurs pays respectifs, de justifier les atteintes aux droits et libertés fondamentales, au nom de la sauvegarde des intérêts du peuple et de la patrie.
En somme, l’essai d’Ousmane Ndiaye, est une exhortation à la lucidité, dans un monde en proie à de profondes mutations, et dans lequel l’Afrique ne peut se satisfaire de constructions idéologiques à l’emporte-pièce, voire obscurantistes, sans se départir du nécessaire enracinement de ses visions d’avenir dans le meilleur de ses cultures et de ses réalités endogènes.



