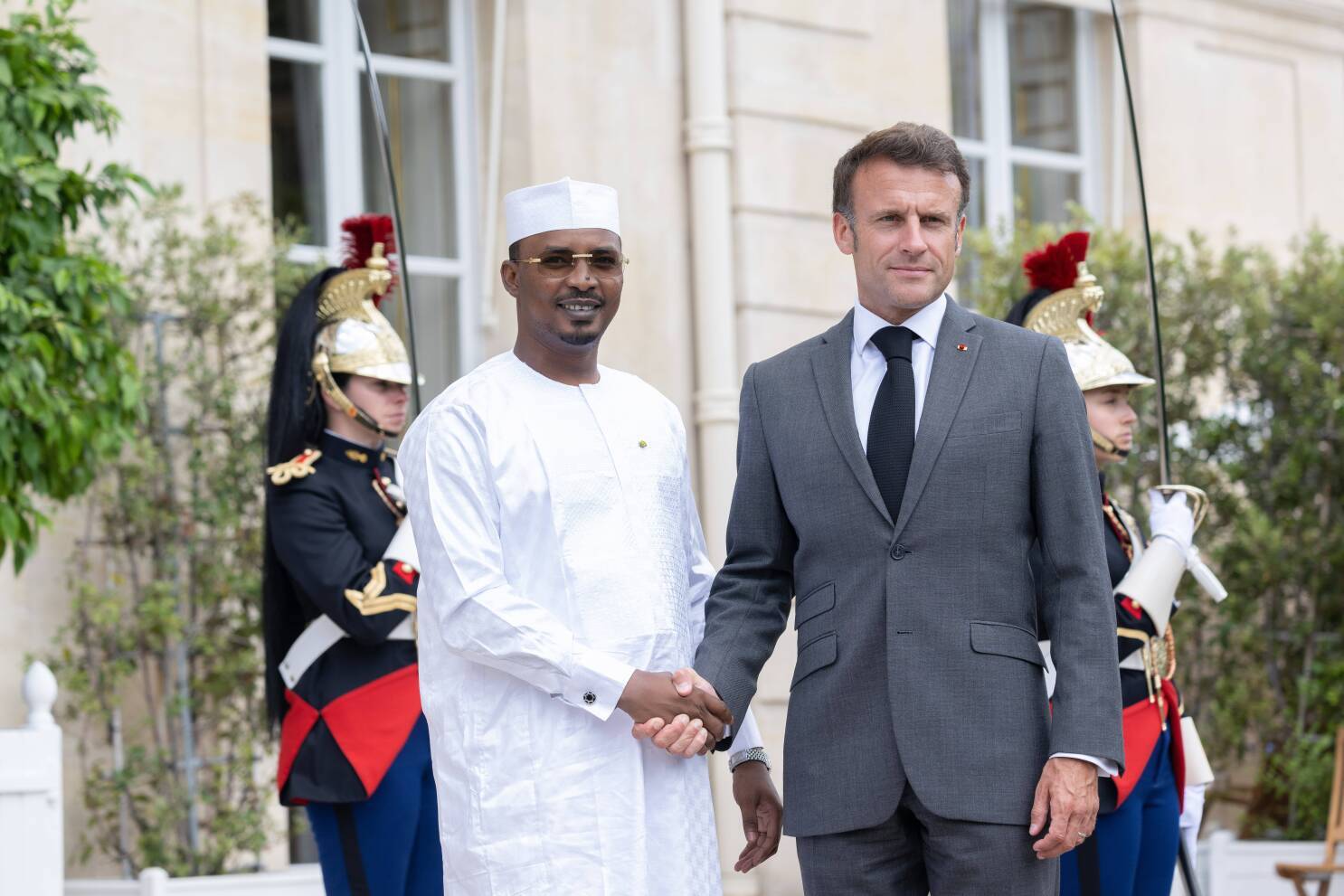La multiplication des procédures judiciaires visant certains professionnels des médias au Tchad constitue un sujet de préoccupation pour Éric Topona Mocnga, journaliste à la Deutsche Welle, qui rappelle que le « journaliste n’est pas l’adversaire de l’État de droit », bien au contraire. Il en est même l’un des garants.
Le ciel de la presse au Tchad ne cesse de se charger de nuages depuis quelque temps, alors que l’on se serait plutôt attendu à une embellie, tout au moins à un dégel sur le terrain de la liberté de la presse. Surtout dans le sillage des résolutions du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) qui a eu lieu du 20 août au 8 octobre 2022 à N’Djaména et de la promulgation de la nouvelle Constitution de la Ve République, le 29 décembre 2023.
Ces deux moments majeurs de la vie politique nationale, de la consolidation de l’État de droit et du processus démocratique ont eu le mérite d’innover plus que par le passé, dans le sens de la protection des libertés fondamentales des citoyens et de la mise en place des mécanismes procéduraux à l’usage des praticiens du droit chargés de veiller au bon usage de ces libertés.
La mise en détention au Tchad depuis plus d’un mois, des journalistes Olivier Monodji Mbaindiguim(Directeur de publication de l’hebdomadaire Le Pays et correspondant local de Radio France internationale), Ndilyam Guekidata et Mahamat Saleh Hisseine, suscite actuellement de légitimes interrogations quant à la volonté de toutes les parties de la nouvelle République, notamment dans le champ de l’exercice des libertés et de leur encadrement, de jouer leur partition à leur niveau de responsabilité.
Des faits graves
Pour ce qu’il nous est donné de connaître suite à la sortie du procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, les trois hommes de médias sont accusés des faits « d’intelligence avec l’ennemi, d’attentat contre les institutions, de complot, et d’atteinte à l’ordre constitutionnel, à l’intégrité et à la sécurité du territoire national ». Ils encourent de vingt à trente ans de prison, selon les avocats. À l’évidence, il s’agit d’accusations extrêmement graves pour qu’on s’y penche, ce d’autant plus que les prévenus risquent jusqu’à trente ans de prison.
Du côté des avocats de la défense, notamment ceux de Olivier Monodji, ils expriment leur surprise et leur stupéfaction de constater que lors de l’audition de leur client dans les locaux de la police judiciaire, il lui a été présenté des coupures de presse comme constitutives des infractions pour lesquels il est placé en détention, et dont il assume par ailleurs la publication parce que persuadé de n’avoir pas dérogé aux canons de sa profession.
Ce nécessaire rappel des faits n’a pas la prétention d’initier une instruction parallèle à celle des magistrats qui ont pleinement qualité et compétence pour le faire.
Interrogations et inquiétudes légitimes
Toutefois, ces arrestations récentes et dont le dénouement ne semble guère proche, suscitent légitimement interrogations et inquiétudes car, depuis 2024, des hommes de médias ou des acteurs de la société civile ont été privés de liberté pour être conduits dans les locaux de l’Agence nationale de sécurité de l’Etat (ANSE), les services de sécurité, en violation flagrante des dispositions du code pénal.
Sur un autre registre, mais récemment, lors des dernières élections locales et législatives, la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) a imposé aux médias en ligne l’interdiction de diffuser des contenus audiovisuels.
Soucieuse de voir l’État de droit respecté, la quasi-totalité de la corporation de la presse tchadienne, mue par une louable combativité juridique, s’est pourvue jusqu’à la Cour suprême qui lui a finalement donné raison.
Ces procédures judiciaires cumulées et si proches les unes les autres dans le temps, permettent de conclure qu’une épée de Damoclès est suspendue en permanence sur la presse tchadienne, à telle enseigne que l’on pourrait conclure à une défiance de certains membres du corps judiciaire envers les médias.
Rôle de veille et d’éveil citoyen
Or, si dans la séparation classique des pouvoirs telle que la conçoit Montesquieu dans l’Esprit des Lois, le pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs régaliens aux côtés de l’exécutif et du législatif, la presse a cette spécificité qu’elle est en revanche un contre-pouvoir dont le devoir d’informer, qui figure au premier rang de ses missions déontologiques, remplit une fonction de veille et d’éveil citoyen et républicain afin que le peuple puisse s’assurer du bon fonctionnement des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire qui exercent leurs attributions au nom du peuple souverain.
Dès lors, aux yeux de certains de ceux qui incarnent ces institutions, le journaliste pourrait apparaître comme ce regard inquisiteur mais dont la profession consiste à se mêler justement de « ce qui ne le regarde pas », s’il nous est permis de paraphraser la célèbre formule de Jean-Paul Sartre au sujet de sa définition de l’intellectuel. C’est dire que le journaliste est un acteur majeur qui contribue de manière éminente au bon fonctionnement de l’État de droit.
Au Tchad comme dans certains Etats africains où les problèmes de gouvernance sont légion et sont déplorés par les discours officiels au plus haut sommet de l’État, le travail d’investigation de la presse est indispensable aussi bien pour la bonne information des gouvernants et des gouvernés.
Cette fonction de sensibilisation citoyenne et de veille pour la sauvegarde des valeurs républicaines et de l’État de droit, ont conduit dans de nombreuses démocraties à la protection des sources des journalistes, à des aides substantielles à la presse, enfin à la dépénalisation des délits de presse.
S’agissant précisément de la dépénalisation des délits de presse, il est souhaitable qu’au Tchad, les journalistes ne soient plus contraints d’exercer ce noble métier la peur au ventre ou dans une autocensure permanente. Il ne s’agit pas de consacrer dans la loi l’impunité des hommes de presse, mais d’encadrer leur profession de garde-fous juridiques qui les soustrait de l’arbitraire des puissants, ou de certains dépositaires de l’autorité de l’État qui seraient tentés de basculer dans l’arbitraire dans l’exercice de leurs fonctions.